chroniques > musique, littérature,
cinéma, art etc
introduction :
Cette
section s’organise comme un blog et apporte pour chaque thème des chroniques
d’albums ou concerts, de livres, de films ou d’expositions d’art au fil de
l’eau.
Bonne
lecture,
Jérôme
(Paris,
le 30 juillet 2009)
chroniques > 2010:
juillet > mouvements d’avant-garde (2ème partie) :
littérature et poésie
cinéma et
théâtre
avril > mouvements d’avant-garde (1ère partie) :
général :
Bauhaus – Dada – Fluxux – Futurisme – Lettrisme -
Néo-Dada – Néoïsme – Minimalisme - Post-minimalisme –
Primitivisme - Internationale Situationniste - Réalisme social - Réalisme
socialiste – Surréalisme - Symbolisme
arts
visuels :
- art moderne avant la seconde guerre mondiale :
Impressionnisme - Post-impressionnisme – Fauvisme - Avant-garde russe - Art
Nouveau – Cubisme – Constructivisme - De Stijl - Suprématisme
- art moderne après la seconde guerre mondiale :
Expressionnisme abstrait - « color field » painting - Pop
art
- art contemporain :
Fluxus - Art conceptuel - « Neue Slowenische Kunst » ou NSK
- autres formes d’art :
Abstraction lyrique - « Incoherents » -
« Mail art »
musique:
Ars subtilior - Avant-garde jazz - Free jazz -
Avant-garde metal - Industrial
music – Krautrock - Musique concrête
- No Wave - Noise music - Post-rock - Progressive
rock
chroniques > 2009:
juillet > groupes de Graham Day
& Billy Childish (2ème partie: 1990s &
2000s):
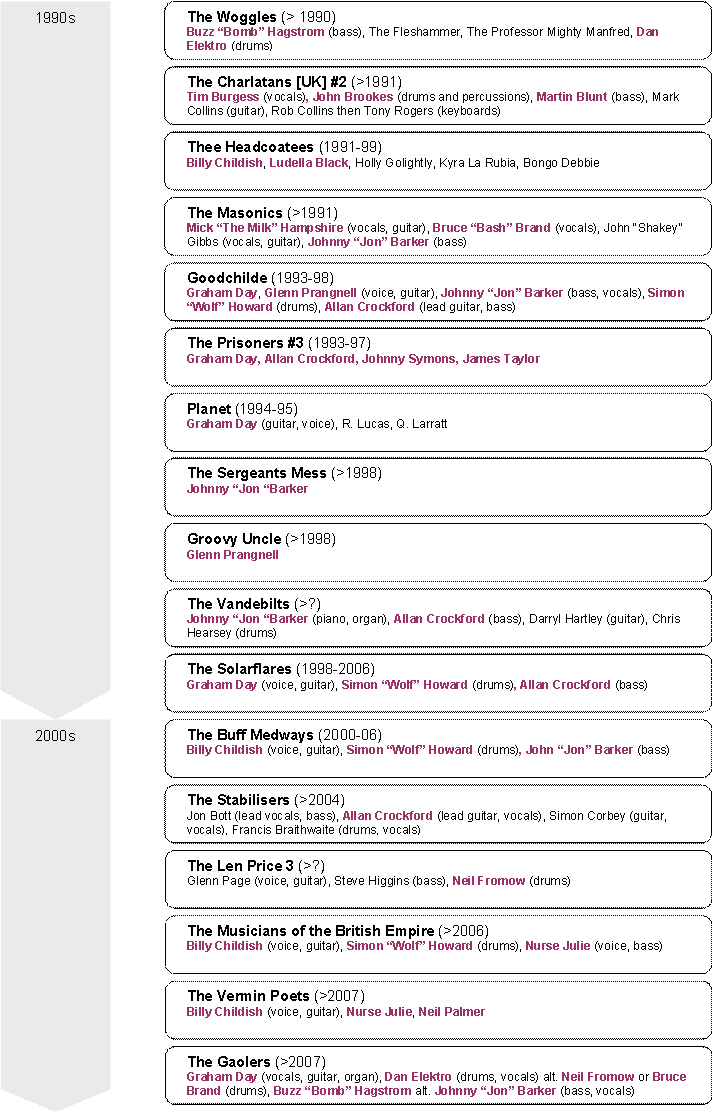
sources:
www.geocities.com/SunsetStrip/Club/3042/
avril > René Barjavel « l’Enchanteur »
(1984) :
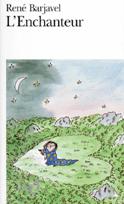
Dans ce roman, René Barjavel revisite la légende
du roi Arthur, de Lancelot du Lac, de la quête du Graal, de Merlin l’Enchanteur
et de la fée Viviane chère à notre enfance. Mais le ton du roman, outre la
malice de Barjavel, est celui de Cervantès et de Don
Quichotte de la Manche auquel il rend hommage en guise d’épitaphe :
« Et Viviane vit, dans une campagne pelée, sur un cheval étique, un
chevalier maigre coiffé d’un plat de barbier et suivi par un âne. Des marchands
gras l’attendaient pour le rosser ». Très agréable, l’Enchanteur est un
conte qui n’envoûtera pas seulement les enfants.
Jérôme Pons
(Paris, le 24 avril 2009)
chroniques > 2008:
octobre > Boris Vian « J’irai cracher
sur vos tombes » (1946) :
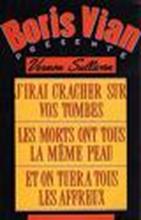
Roman écrit du 5 au 20 août 1946 et paru en novembre 1946 sous le patronyme
de Vernon Sullivan. Ce livre est la meilleure vente de 1947. Le 7 février 1947,
une première plainte est déposée, la seconde suivra en 1948, et le roman sera
interdit par arrêté ministériel le 3 juillet 1949. Du 29 avril au 13 mai se
tient le procès suite aux deux plaintes et à l’interdiction de « J’irai
cracher sur vos tombes ». Le procès concerne également « Les morts
ont tous la même peau » et Vian est condamné pour outrage aux moeurs par
la voie du livre. En octobre 1953, une amnistie annule le verdict touchant les
oeuvres de Vernon Sullivan. Le 23 juin 1959, lors de la projection privée de
« J’irai cracher sur vos tombes », adapté au cinéma en partie contre
son gré, Vian décède d’une crise cardiaque.
Jérôme Pons
(Paris, le 19 octobre 2008)
juin > John Irving « L’hôtel
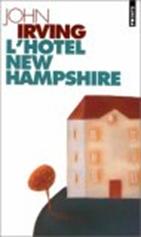
La vie selon John Irving :
« Toute la première moitié de sa vie, on a quinze ans. Et puis, un jour, on
accroche ses vingt ans, et le lendemain c’est déjà fini. Et la trentaine défile
comme un week-end passé en galante compagnie. Et avant de s’en rendre compte,
on recommence à rêver de ses quinze ans .»
« La vie, c’est une longue ascension [...] jusqu’à ce qu’on ait quatorze ou
seize ans. Et ensuite, [...] on n’arrête pas de descendre. Et tout le monde le
sait, ça va plus vite à la descente qu’à la montée. »
C’est tellement vrai !
Jérôme Pons
(Paris, le 10 juin 2008)
juin > John Fante « Mon chien Stupide» (1985,
posthume):
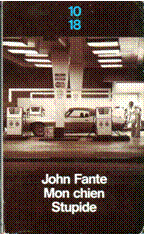
John Fante et son rapport à la musique que je
chéris :
« J’ai descendu un autre verre en savourant le calme après l’orage. De
l’aile nord de ma maison en forme de Y arrivait le vacarme de la chaîne stéréo
de Dominic, les rythmes décérébrants des Mothers of Invention. J’en étais arrivé à détester
l’indicible grossièreté de ce bruit. J’ai levé les yeux vers San Gennaro et lui ai dit : Combien de temps encore, O Gennaro, dois-je souffrir ? D’abord Presley et Fats
Domino, ensuite Ike et Tina Turner, puis une éternité de Beatles et de Grateful Dead, les Monkees, Simon et Garfunkel, les Doors,
le Rotary Connection, tous sans exception ont violé
l’intimité de ma maison, toute cette putain de barbarie a envahi mon foyer
d’année en année, ce fils de pute avait vingt-quatre ans et était encore un
foutu emmerdeur. »
Jérôme Pons
(Paris, le 10 juin 2008)
juin > Bret Easton Ellis « American Psycho» (1991) :
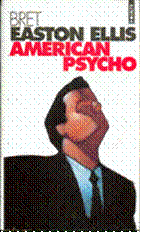
C’est l’histoire de Patrick Bateman, un golden
boy et serial killer qui a le soucis du détail vestimentaire et des soins pour
homme.
C’est aussi un fan de Genesis de la période 80s
depuis la sortie de « Duke » (1980) puis « Acabab »
(1981) jusqu’à « Invisible Touch » (1986).
En effet Patrick Bateman n’est, entre autres, pas fan
de « The lamb lies
down on Broadway » jugé trop « artistique », trop
« intellectuel ». Le départ de Peter Gabriel y étant pour quelque
chose selon lui.
Une digression de six pages sur le parcours de Genesis
se trouve donc dans ce bouquin, ce qui, pour moi, constitue en quelque sorte un
fait marquant !
Jérôme Pons
(Paris, le 10 juin 2008)
chroniques > 2007:
juin > Groupes de Graham Day
& Billy Childish (1ère partie : 1970s &
1980s):
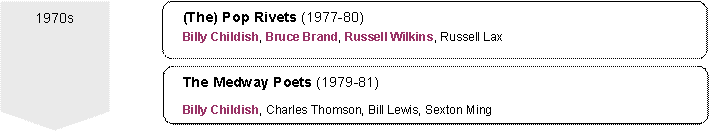
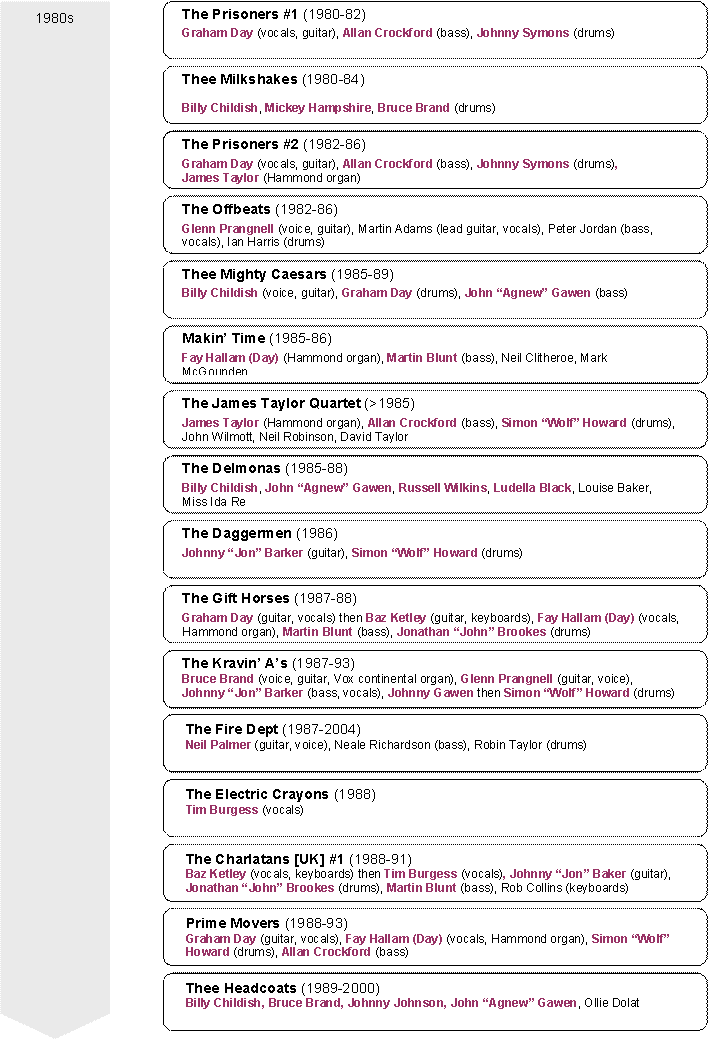
Sources:
www.geocities.com/SunsetStrip/Club/3042/
juin > Groupes de Detroit (Michigan, US) :
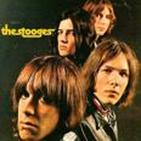
Pour en savoir plus sur les
groupes de Detroit tels que ceux de George Clinton (Funkadelic, Parliaments, P-Funk…),
d’Iggy Pop (The Stooges…), John Lee Hooker, Ted Nugent,
Grand Funk Railroad, Cactus, The Silencers, Rare Earth, Bob Seger, Alice Cooper, The Von Bondies, The White Stripes, Eminem,
The Detroit Cobras ou bien MC5, visitez le site web suivant: http://www.detnews.com/index.htm.
Jérôme
Pons
(Paris, juin 2007)
mars > René Barjavel « La charrette bleue » (1980):
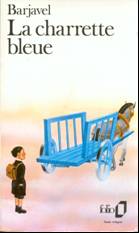
Ce roman
autobiographique de Barjavel nous fait prendre
conscience de tous les gaspillages de la société de surconsommation d’aujourd’hui, en décrivant la vie à la campagne dans les
années 1920. Les années où l’on achetait des vêtements qui dureraient une vie
(et que l’on raccommodait sagement assis
au coin du feu), où l’on aiguisait ses couteaux chez le rémouleur, où l’on
faisait étamer les bassines et brocs troués, où les paysans se faisaient
construire des charrettes en bois qui devaient être utilisées sur plusieurs
générations, où l’on achetait des kilogrammes de savon etc. Aujourd’hui, nous
jetons tout, c’est aberrant !
Barjavel raconte son enfance à Nyons dans la boulangerie de ses
parents avec une simplicité et une beauté saisissante, nous montre le respect
et l’estime qu’il portait pour ses parents, les gens de son village, ses
professeurs.
On y apprend
que « Colomb de la Lune » est celui des romans de Barjavel
qui est « le plus cher à [son]
esprit et à [son] coeur.»
Comme je suis
un vrai « caféinomane », je ne peux pas
m’empêcher de citer un passage dans lequel la « mère Mourier », l’épicière,
« « brûlait » elle même
son café [...] dans un cylindre de fer noir vertical, posé sur trois pieds
et se terminant par une cheminée en forme de chapeau pointu [... qui] contenait
une sphère creuse dans laquelle elle mettait le café vert, et qu’elle faisait
tourner lentement au moyen d’une manivelle, après avoir allumé du charbon de
bois dans le bas du cylindre. » A la suite de quoi, « le merveilleux parfum du café qu’on grille
envahissait aussitôt tout le quartier. » Barjavel
nous confie alors que pendant la Seconde Guerre Mondiale, la « privation qui [l’] a le plus touché a
été celle du café. » et là on reconnaît le vrai « caféinomane » car il décrit très bien la sensation du
café du matin: «j’en bois peu, une tasse
par jour, le matin, mais tant que je ne l’ai pas bue je ne suis pas un homme
vraiment vivant. »
Ce livre est
une invitation au respect et à l’humilité face à notre époque. Je crois que ma
génération ne sait pas quelle chance elle a d’avoir autant de facilités
relativement au siècle d’avant.
Jérôme
Pons
(Paris, le 3 mars 2007)
mars > Frédéric Beigbeder « Mémoires d’un jeune homme dérangé » (1990):
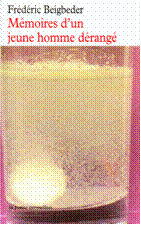
Dans ce roman, Beigbeder
introduit le personnage de Marc Maronnier, diplômé de
Sciences Po, fêtard et collectionneur de bandes
dessinées de Jacques de Loustal et de disques de Sergio Mendes.
Il peint en outre une vie de noctambules
dans laquelle, « la nuit, les gens
ne suent pas : ils suintent» ainsi que « les ricaneurs pantalonnés » qui sont
décrits comme « riches mais
généreux » et réunissant « des
étudiants ivres, des experts en arts barbus, des fils à papa orphelins
[...] » qui sont « drôles
jusqu’aux larmes et méchamment gentils. »
Ces personnages sont en marge de leur
époque : « ils n’auraient pas
été zazous dans les années 40, ni existentialistes dans les années 50, ni yéyés
dans les années 60, ni hippies dans les années 70, ni yuppies dans les années
80 : mais ils seraient tout cela à la fois avant l’an 2000. »
Marc Maronnier
forme, avec Victoire, un « jeune
couple dynamique » dont les « deux
égoïsmes se complétaient et que [leur] paresse sentimentale [...] rapprochait considérablement.»
Ce court roman ouvre sur le destin de
Marc Maronnier que l’on retrouvera dans
« Vacances dans le coma. »
Jérôme
Pons
(Paris, le 8 mars 2007)
mars > Frédéric Beigbeder « Vacances dans le coma » (1994) :

Ce roman prolonge la vie de Marc Maronnier, « jeune
chroniqueur mondain » et ami du
disk-jockey Joss Dumoulin.
Le tableau sur lequel repose cette histoire est une nouvelle boîte de nuit
appelée « Les Chiottes.»
Beigbeder se frotte
au monde du « DJing » et décrit l’un de
leurs outils le plus précieux : le sampleur.
Selon lui, « le sampleur
permet de piquer les meilleurs passages de n’importe quel morceau de musique
pour les recycler à la chaîne sur des tubes de danse .
Grâce à cette invention, les disc-jockeys, qui n’étaient auparavant que de
vagues juke-boxes humains, sont devenus des musiciens à part entière.»
Marc Maronnier
vit avec son temps alors il n’a pas encore de téléphone mobile mais seulement
un récepteur Bi-Bop et, pour ne pas être dérangé en
pleine soirée « aux chiottes », « Marc vérifie qu’il n’est pas dans une zone d’appel pour Bi-Bop. Non, aucun sigle tricolore à
portée de vue. Il ne faut donc pas s’inquiéter. Il est normal que son téléphone
ne sonne pas. Marc restera injoignable pendant encore six cents mètres. »
Encore un roman teinté d’un humour
parfois piquant mais toujours frais. Les aventures de Marc Maronnier
se poursuivent dans « L’amour dure trois ans.»
Jérôme
Pons
(Paris, le 8 mars 2007)
mars > Alain Mabanckou « Verre cassé » (2005):
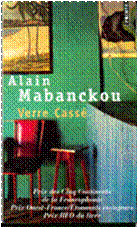
« Verre Cassé » est le nom d’un
client du café « Crédit a voyagé » auquel le patron demande d’écrire
les histoires des habitués du lieu.
Alain Mabanckou
nous fait passer ses références littéraires au travers de ce qu’il considère
comme une « vraie bibliothèque
ambulante » et contient « les
Arthur Rimbaud, les Benjamin Constant, les Baudelaire et surtout Chateaubriand
et ses Mémoires d’outre-tombe [... ]» ainsi
qu’Alexandre Dumas et son Comte de Monte-Cristo et plus loin Marcel Proust,
Ernest Hemingway, un « écrivain
célèbre qui buvait comme une éponge » (Charles Bukowski ?)
et Labou Tansi et Mongo Beti. De même, il cite un certain nombre de peintres tels
que « William Blake, Francis Bacon,
Robert Rauschenberg, James Ensor » et la « fondation Dubuffet.»
Alain Mabanckou
pose aussi un regard critique sur la société.
A propos de Chateaubriand, « il écrit avec un fouet, il vous apostrophe,
j’ai dévoré Atala, et j’ai pleuré quand j’ai découvert après coup que le père
de Chateaubriand avait été un marchand d’esclaves, et il n’en a jamais parlé
dans ses Mémoires.»
Concernant la grammaire française, « j’aimais leur apprendre [aux élèves]
les participes passés conjugués avec l’auxiliaire avoir et qui s’accordent ou
ne s’accordent pas selon qu’il fait jour ou nuit, selon qu’il pleut ou ne pleut
pas, et les pauvres petits, hébétés, désemparés, parfois révoltés, me
demandaient pourquoi ce participe s’accorde aujourd’hui à 16h alors qu’il ne
s’accordait pas hier à midi avant la pause déjeuner, et moi je leur disais que
ce qui était important dans la langue française, c’était pas les règles mais
les exceptions [...] »
A propos des intellectuels, «ça discute et ça ne propose rien de
concret à la fin, ou alors ça propose des discussions sur des discussions à
n’en pas finir, et puis ça cite d’autres intellectuels qui ont dit ceci ou cela
et qui ont tout prévu, et puis ça se frotte le nombril [...], comme si on ne
pouvait pas vivre sans philosopher, le problème c’est que ces pseudo
intellectuels philosophent sans vivre, ils ne connaissent pas la vie
[...] »
J’ai adoré ce livre que je vous conseille
pour vous rafraîchir entre « Guerre et Paix » et « Les Mémoires
d’outre-tombe.»
Jérôme
Pons
(Paris, le 8 mars 2007)
février > Christian Gailly « Un soir au club » (2001 ou 2002):
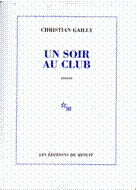
C’est
l’histoire d’un pianiste de jazz qui se retrouve en tant qu’artiste. Comment
apprend-on le jazz pour Simon Nardis ? « L’écoute, juste l’écoute, écoutez les grands,
prenez-leur tout ce qu’on peut leur prendre, ensuite débrouillez-vous. Les
médiocres s’éliminent d’eux-mêmes.» Comment revient-on au jazz ? « Il était soûl. Donc lucide. Soûl on
voit très clair en soi.» Ce roman et très agréable, lisez-le !
Jérôme
Pons
(Paris, le 23 février 2007)
février > Christian Jan Yoors « La croisée des
chemins : histoire secrète des Tsiganes » (1940-44):
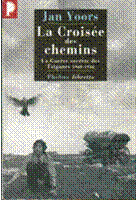
Quelques proverbes, us et coutumes :
« Les
Lovara disent qu’un homme choisit sa bru « avec
les oreilles et non avec les yeux », entendez par là qu’il faut attacher
plus d’importance à la réputation d’une fille qu’à sa beauté. »
« Le
bois volé brûle encore mieux que les autres. »
Un peu d’histoire, pour ne pas oublier
l’indicible :
Dès la prise de pouvoir par les nazis en
Allemagne, les Tsiganes subirent des mesures discriminatoires en tant qu’artfremdes Blut (ou sang
étranger) notamment de la part du commandant Hans Globke,
le professeur en « sciences raciales » Hans Günther, Robert Körber et le
spécialiste des gitans Robert Ritter (qui fût « dénazifié » en 1950).
A partir de 1936, de nombreux Tsiganes
furent ainsi arrêtés et envoyés aux camps de Dachau et Ravensbrück. Les plus
importantes dates d’arrestation des Tsiganes sont 1939, 1941 et 1943. Le nombre
de Tsiganes victimes du génocide est évalué à 500 000 à 600 000.
Jan Yoors
conclut par : « Je
pleurais à présent sans me cacher, ouvertement, je pleurais ceux qui aimaient
tant la vie et dont la vie avait été détruite parce qu’ils représentaient une
prétendue menace pour le IIIe Reich, et peut-être aussi parce qu’ils croyaient
qu’on pouvait vivre libres.»
Jérôme Pons
(Paris, le 23 février 2007)
chroniques > 2006:
avril > William H. Faulkner « Sartoris » (1929) :

Je viens à peine de commencer à
découvrir la famille Sartoris que je suis perdu par
le nombre impressionnant de personnages qui sont globalement tous désignés par Sartoris, Bayard, Bayard Sartoris...
Alors une pause est nécessaire pour faire un bilan généalogique de tous les
personnages principaux qui hantent ce roman déjà génial. Comme je ne suis pas
certain de l’arbre généalogique que j’ai déjà tracé grâce aux 200 premières
pages, je me permets de m’inspirer d’un site éducatif américain [6] sur la
figure ci-dessous.
Jérôme
Pons
(Paris, le 13 avril 2006)
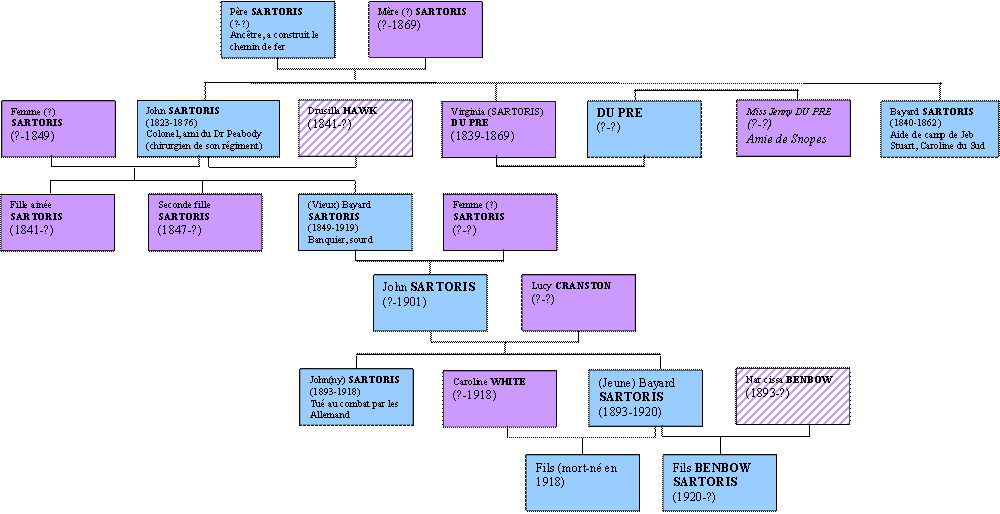
The Sartoris
family tree
mars > John Fante (1909-1983): Bandini,
mon bon ami !
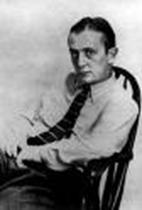
John Fante (à prononcer « fanté »)
est un auteur qui a su imprimer dans son écriture une totale spontanéité telle
que nous pouvons immédiatement nous approprier ses souvenirs. Ce sont des
romans de la terre, de gens qui en ont bavé... John Fante
s’inspire de Fedor Mikhaïlovitch
Dostoïevski entre autres.
Jérôme Pons
(Paris, le 1 mars 2006)
(révisé le 30 juillet 2010)
mars > Charles Bukowski « Factotum » (1975) :
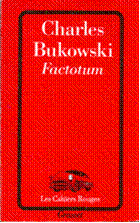
Raphaël Sorin a
écrit dans la préface de « Factotum » un excellent résumé de la vie
de « Buk » ou « Buko »,
né en Allemagne et dont les parents ont émigré aux USA. On y apprend qu’il a
été publié par Lawrence Ferlinghetti un poète et
éditeur des Beatniks à San Francisco (alias « Frisco »)
si bien qu’il sera catalogué avec les auteurs de la « Beat Generation » tels Jack Kerouac, William Burrough, Allen Ginsberg, Neal Cassady...
Sorin retrace également la découverte
de Bukowki par les Français avec son apparition dans
l’émission Apostrophe de Bernard Pivot, le 22 septembre 1978 (ce qui me fait
penser que j’ai toujours cru avoir vu cette émission en direct alors que bien
évidemment, il s’agissait d’une rediffusion une dizaine d’années plus
tard !) Après avoir descendu son litre de vin blanc devant un Bernard
Pivot médusé et un Cavanna hargneux, « Buko »
se vit expulser du plateau télé ! L’évènement fit écho jusqu’à New York et
le cinéaste Marco Ferreri adapta aussitôt les « contes de la folie
ordinaire » avec Ben Gazzara dans le rôle de
« Buko ».
Après le scandale d’Apostrophe, je génie
de Charles Bukowski fut salué par Philippe Sollers et
Alphonse Boudard. Le blason de « Buko » fut en partie redoré et celui-ci s’installa
alors à Los Angeles pour y mourir malheureusement
d’une leucémie en 1994 (ça doit être en 1994 que j’ai vu la rediffusion
d’Apostrophe !).
L’édition Grasset de
« Factotum » que je me suis procurée comporte 87 nouvelles. Voici des
extraits de celles qui m’ont marqué (les nouvelles ne portent pas de titre et
j’y réfèrerai par leur numéro) :
#14 : Bukowski, alias « Chinaski »,
qui n’a pas vu ses parents depuis des lustres se retrouve en prison pour
ivresse sur la voie publique et son père vient payer la caution de 30 dollars
pour le libérer. Son père lui dit alors « tu
nous as déshonorés, ta mère et moi » et le père lui rappelle en plus
sa déception lorsque son fils n’a pas servi son pays durant la seconde guerre
mondiale... Au père peiné, « Chinaski » répond
que « le pays l’a déclaré inapte »,
demande à son père une cigarette, lui propose d’aller « boire un coup » et lui explique qu’il a « besoin de baiser un coup aussi » !!!
Après le père lui rappelle que son hébergement chez papa maman ne sera pas sans
frais (« note de loyer, nourriture
et blanchissage ») . Après le fils
ingrat, le père indigne !
#29 : Bukowski raconte comment Clay Gladmore
a accepté de publier l’une de ses quatre nouvelles : « Mon âme gorgée de bière est plus triste que
tous les sapins de Noël crevés du monde ».
#34 :
Cette nouvelle est odieuse mais tellement drôle !
#62 :
« Chinaski » raconte comment il a attrapé
des morpions (et oui, ça existe apparemment !). En voici la description
lors de sa trouvaille : « C’était
blanc et ça avait des pattes minuscules. Ca bougeait. Ca me fascinait. D’un
seul coup, ça a sauté sur le carrelage de la salle de bain. Je l’ai fixé. D’un
bond rapide ça avait disparu. » Je crois qu’en lisant ce passage j’ai
tellement ris dans le métro que mes voisins ont du penser que j’étais
timbré ! Ensuite, « Chinaski » cherche
à se débarrasser de ses petites bêtes et se rend tout bonnement à la pharmacie
du coin. « Chinaski » demande à un vieux
pharmacien un insecticide, « quelque
chose pour [... les] araignées, puces... moustiques, poux... » mais le pharmacien est sourd et «Chinaski »
se retrouve obligé de hurler « avez-vous
quelque chose contre les morpions ? » et là j’ai encore rigolé
pour la seconde fois (entre Denfert-Rochereau et Saint Jacques pour être
exact). Finalement, « Chinaski » ressortira
de la pharmacie avec un onguent qu’il devra s’appliquer. L’application est
censée durer trente minutes et « Chinaski »
se dit qu’il hait tellement les morpions qu’il va laisser l’application produire
son effet durant une heure ! Résultat des courses : après trois
quarts d’heure, la crème commence à le brûler ! Et que se dit « Chinaski » ? Qu’il va « zigouiller jusqu’au dernier tous ces petits branleurs !»
Au final, il s’est brûlé après une heure de réaction et a fini par ne plus
pouvoir se remuer le derrière !
#65 :
« Chinaski » raconte comment il a bouché
les toilettes. Ce n’est pas possible ! C’est vraiment du vécu cette
histoire pour la raconter avec tant de minutie ! Le fou rire incontrôlable
s’est déclenché entre Convention et Porte de Versailles. Heureusement pour moi,
mes voisins de la ligne 12 n’étaient plus les mêmes que ceux de la ligne
6 !
Ce recueil de nouvelles est un rayon de
soleil pour qui saura en apprécier la finesse et la juste valeur.
Jérôme
Pons
(Paris, le
1 mars 2006)
(révisé le 19 mars 2006)
mars > John Irving « Le monde selon Garp »
(1976-1978) :
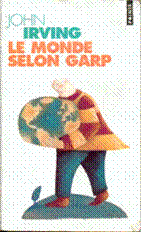
Ce livre est tout
simplement fantastique ! Il parle, entre autres, de la concupiscence,
le « désir des plaisirs sensuels » comme la décrit le Larousse
( !), via la plume de Jenny Fields, la mère de S. T. Garp.
On y trouve des personnages fort sympathiques (les Ellen-Jamesiennes
qui se mutilent volontairement la langue, Roberta Muldoon,
transsexuel et ancien ailier n°90...) ainsi que les thèmes omniprésents de
féminisme et de misogynie qui peuvent se résumer à cet extrait du roman de
Jenny Fields :
« Dans ce monde à l’esprit pourri, une femme ne saurait
être que l’épouse ou la putain d’un homme; du moins ne tarde-t-elle pas à
devenir l’une ou l’autre. Si une femme ne correspond à aucune des deux
catégories, tout le monde s’efforce alors de lui faire croire qu’elle n’est pas
tout à fait normale » !
John Irving
fait également référence à ces prédécesseurs : Joseph Conrad avec « L’agent
secret » (« The secret sharer »)
et D.H. Lawrence avec « The man who loved islands ».
Il semble que
le narrateur ait été marqué par la seconde guerre mondiale et plus
particulièrement par la ville de Vienne sous l’occupation nazie. Le narrateur précise que de 1938 à 1945 peu de naissances sont survenues
dans la capitale autrichienne et « bien
qu’un nombre élevé de grossesses eussent été provoquées par des viols, peu de
Viennois voulurent avoir des enfants avant 1955 – la fin de l’occupation
russe» ironise-t-il !
Eh oui, on oublie bien souvent que Vienne a été occupée et par deux fois
au moins.
Jérôme
Pons
(Paris, le 1 mars 2006)
(révisé
le 18 mars 2006)
mars > J. D. Salinger « L’attrape-coeurs » (1945) :
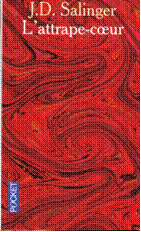
Ce livre parle de
l’adolescence et se lit vraiment bien. Certains passages expriment la pleine fraîcheur et la naïveté de
l’adolescence mais montrent déjà une grande compréhension et un certain
recul par rapport à la vie, de la part du narrateur. Par exemple lorsque le
narrateur entame un boogie-woogie dans un bal avec une demoiselle dont il tombe
amoureux le temps d’une danse : « Quand
on est allés se rasseoir j’étais à moitié amoureux d’elle. Les filles c’est
comme ça, même si elles sont plutôt moches, même si elles sont plutôt connes,
chaque fois qu’elles font quelque chose de chouette [comme bien danser le
boogie-woogie par exemple] on tombe à moitié amoureux d’elles et alors on sait
plus où on est. Les filles. Bordel. Elles peuvent vous rendre dingue. Comme
rien. Vraiment.»
Après l’amour, la mort
est également abordée mais toujours avec légèreté surtout lorsque le narrateur
se prend à imaginer sa propre mort : « Et puis j’ai pensé à toute la bande qui me foutrait au cimetière et
tout, avec mon nom sur la tombe et tout. Au milieu de ces foutus trépassés.
Ouah, quand on est mort, on y met les formes pour vous installer. J’espère que
lorsque je mourrai quelqu’un aura le bon sens de me jeter dans une rivière.
N’importe quoi plutôt que le cimetière. Avec des gens qui viennent le dimanche
vous poser un bouquet de fleurs sur le ventre et toutes ces conneries. Est-ce
qu’on a besoin de fleurs quand on est mort ? ».
Les rapports humains
sont également abordés avec quelques réflexions fort intéressantes :
« c’est marrant, suffit de
s’arranger pour que quelqu’un pige rien à ce qu’on dit et on obtient
pratiquement tout ce qu’on veut ».
Au bout de 200 pages on
comprend le nom du livre qui est tiré d’un poème de Robert Burns : « si un corps rencontre un corps à travers les
seigles » qui est mal interprété par le narrateur qui comprend plutôt
« si un coeur attrape un coeur qui
vient à travers les seigles» ; ce qui lui inspire « tous ces petits mômes qui jouent à je ne
sais quoi dans le grand champ de seigle et tout. Des milliers de petits mômes
et personne avec eux je veux dire pas de grandes personnes – rien que moi. Et
moi je suis planté au bord d’une saleté de falaise. Ce que j’ai à faire c’est
d’attraper les mômes s’ils s’approchent trop près du bord. Je veux dire s’ils
courent sans regarder où ils vont, moi je rapplique et je les attrape. C’est ce
que je ferais toute la journée. Je serais juste l’attrape-coeurs
et tout. D’accord, c’est dingue, mais c’est vraiment ce que je voudrais être.
Seulement ça. D’accord, c’est dingue. »
Et comme le narrateur
n’est vraiment pas une flèche à l’école, il a le droit au genre de morale
suivante : « le jour où tu
t’apercevras que de toutes tes études tu n’as retiré que juste ce qu’il faut
pour pouvoir détester les gens qui disent « je m’en souviens » et pas
« je m’en rappelle. » ou encore « L’homme qui manque de maturité veut mourir noblement pour une cause.
L’homme qui a atteint la maturité veut vivre humblement pour une cause. »
Jérôme
Pons
(Paris, le 1 mars 2006)
(révisé
le 19 mars 2006)
mars > Frédéric Beigbeder « 99 Francs » (2000) :
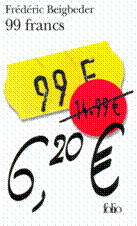
Ce livre est une satire du monde de la
publicité dans lequel Octave, publicitaire, évolue et « pollue
l’univers ». Le but d’Octave est de « vous faire baver » car dans sa « profession, personne ne souhaite votre bonheur, parce que les gens
heureux ne consomment pas » ! Pour cela, Octave doit être créatif
et énumère les « dix commandements du créatif » :
1)
Ne pas s’adresser aux consommateurs mais aux directeurs de
création des 20 agences de pub parisiennes
2)
La première idée est la meilleure et il faut attendre trois
semaines avant de la présenter
3)
Ne pas hésiter à dégrader une « idée géniale » pour faire plaisir à l’annonceur et ajouter des
palmiers dans le «story-board pour partir tourner au soleil
4)
Toujours arriver en retard aux réunions pour être crédible
5)
Lorsque l’on a rien préparé avant d’assister à une réunion,
parler le dernier et reprendre tout ce que les autres ont dit (sauf les
stupidités !) à son compte car le dernier qui parle a toujours raison
6)
Plus on est important (créatif senior), moins il faut
parler, pour que l’on pense que nous sommes géniaux ! « Corollaire : pour vendre une idée au directeur
de création, le créatif doit systématiquement [lui] faire croire que c’est
[lui] qui l’a eue » ! Pour
distinguer un créatif Junior d’un senior : « le junior dit des blagues drôles qui ne font rire personne, alors que
le senior sort des vannes pas drôles qui font rire tout le monde » !
7)
Cultiver l’absentéisme et arriver au travail à midi et si
on nous fait le moindre reproche, annoncer qu’ « un créatif n’a pas d’horaires, il
n’a que des délais » !
8)
Ne pas demander d’avis à autrui sur une campagne
9)
Tout le monde fait le travail de son supérieur. Par
conséquent, déléguer son propre travail à un stagiaire
10) Quand un
autre créatif vous soumet une belle annonce, ne pas lui dire qu’elle nous plaît
mais tout le contraire ; et vice versa
Personnellement je suis tout à fait
d’accord avec le troisième point !
Le roman est ponctué de publicités aussi
croustillantes les unes que les autres qui m’ont encore valu de me tordre de
rire dans le métro au désespoir de mes voisins (s’ils ont remarqué quelque
chose d’autre que leurs peaux mortes au bout des doigts et le dernier texto
qu’ils ont reçu sur leur téléphone mobile !). Celles qui m’ont le plus plu
sont « l’homme qui sniffe de la lessive Ariel et entre dans une machine à
laver » et « le défilé de mannequins nus à combinaisons
zippées »,.
Octave s’attaque à toutes les fêtes
commerciales que sont la fête des mères, la St Patrick... et compare Halloween
et la Toussaint en ces termes : « A
la Toussaint on allait visiter ses morts alors qu’à Halloween ce sont les morts
qui viennent nous rendre visite. C’est bien plus pratique, y a aucun effort à
faire. Tout est là : la mort sonne à ta porte ! [...] La mort
VRP. »
Octave distingue deux types de
couples : le couple « DINK
(Double Income No Kids) », c’est–à-dire le couple aux deux revenus (tant qu’à faire élevés)
et sans enfants ; le couple qui paie des impôts à plein pot ! Il y a
également la « FAMILLE (Fabrication
Artificielle de Malheur Interminable et de Longue Lymphatique Emollience )»
mais là il faut que je consulte mon Larousse ! « Emollient : se
dit d’un médicament, d’une application qui relâche, amollit les tissus
enflammés » L’analogie est un peu forte mais tout à fait
compréhensible !
Ensuite, Beigbeder
s’attaque à Louis-Ferdinand Céline, auteur de
« Voyage au bout de la nuit » (1932). Ca me plaît de lire un résumé
de ce livre car après trois tentatives pour le terminer je ne me souviens pas
de l’histoire alors la voici racontée par Octave : « le héro de son plus célèbre roman s’appelle Bardamu
et il fait le tour de la planète à la recherche d’un coupable. Il traverse la
guerre, la misère, la maladie, il va en Afrique, en Amérique, et il ne trouve
jamais le responsable de notre désolation ». C’est volontairement
réducteur comme résumé car en voici la chute : « Le livre est sorti en 1932 et cinq ans plus tard, Céline se trouvait un
bouc émissaire : les juifs ». En effet, Céline était engagé dans la collaboration du régime de
Vichy. Pas drôle ce passage du livre mais il a le mérite d’être clair. Ca me
rappelle un débat entre George Charpak (anti-Céline) et Fabrice Luchini
(officiellement contre les actions de Céline, mais pro-Céline
en ce qui concerne son oeuvre littéraire) qui s’épouillaient en ce qui concerne
le paradoxe « auteur génial / déporteur ». Mais on pourrait en dire
autant du Maréchal Pétain en ce qui concerne le paradoxe de ses actions durant
la première et la seconde guerre mondiale...
Le pouvoir est
également abordé dans ce roman. En effet, pour Octave, « le pouvoir est une invention révolue. Les
pouvoirs d’aujourd’hui sont si multiples et dilués que le système est devenu
impuissant ».
Et voilà une
anecdote pour distinguer les riches des pauvres (au cas où ça ne serait pas
évident !) : «les pauvres
vendent de la drogue pour s’acheter des Nike alors que les riches vendent des Nike pour s’acheter de la drogue ». En
gros pour Octave, les riches sont des toxicos qui sniffent toutes la journée et
les pauvres viennent des banlieues défavorisées et sont tous des drogués qui
dealent pour survivre... Je ne ferai pas d’autre commentaire car vous avez
compris que je ne suis pas d’accord !
Voilà, j’ai terminé ma critique, j’espère
qu’elle vous donnera envie de lire ce livre car il est très drôle. Lisez-le au
dixième degré et ne faites pas l’erreur de penser que Beigbeder
et Octave ne font qu’un ! Dans la même veine, lisez en parallèle « Le principe de Peter » de L.
J. Peter & R. Hull ainsi que « American Psycho » de Bret
Easton Ellis. Je sais ça
n’a rien à voir mais j’ai trouvé des connexions entre ces trois livres.
Jérôme Pons
(Paris, le
11 mars 2006)
(révisé le 18 mars 2006)
(révisé le 19 octobre 2008)
mars > Louis-Ferdinand Céline « Voyage au bout de la nuit » (1932) :

Après trois tentatives (70 premières pages à la 1ère lecture ; 180
premières pages à la seconde tentative),
c’est au 3ème essai que j’ai réussi, en repartant du début du livre
encore une fois, à venir à bout de ces 400 pages...
Jérôme
Pons
(Paris, le 18 mars 2006)
(révisé le 30 juillet 2010)
mars > Philippe Delerm « La première gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules » (1997) :

J’étais en
train de composer une chanson « Plaisirs
égoïstes » sur les petits plaisirs de la vie de tous les jours (par
exemple l’odeur de l’asphalte après un gros orage en été...) lorsqu’une
collègue de travail me demande si je connais Philippe Delerm.
Et bien pas du tout ! Alors je commence par lire ce recueil de nouvelles
qui offre un réconfort et une légèreté à quiconque le lit. Entre autres
plaisirs de Philippe Delerm : « le paquet
de gâteaux du dimanche matin », « Aider à écosser les petits
pois », « le bruit de la dynamo », « l’inhalation »,
« on pourrait presque manger dehors », « aller aux mûres »,
« la première gorgée de bière », « l’autoroute la
nuit », « lire sur la plage », « apprendre une nouvelle
dans la voiture », « mouiller ses espadrilles », « le
bibliobus », « la bicyclette et le vélo »... Je ne sais pas si
c’est le cas pour vous mais je me reconnais dans toutes ces histoires... J’en
déduis aussi que je possède un vélo alors que je rêve de posséder une
bicyclette ! (lisez ce livre envoûtant et vous
comprendrez !)
Jérôme
Pons
(Paris, 11
mars 2006)
(révisé le 18 mars 2006)
(révisé le 30 juillet 2010)
mars > Romain Gary
« Education Européenne » (1945) :

Romain Gary y
donne sa définition de nationalisme (amour de la nation ou « haine des
autres ») de patriotisme (amour
d’un peuple ou « amour des siens ») : « le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme,
c’est la haine des autres ».
Jérôme Pons
(Paris, 18
mars 2006)
mars > Marguerite
Yourcenar « Nouvelles orientales » (1938) :
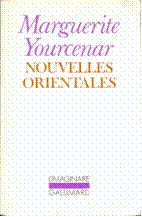
J’ai découvert
ce recueil de nouvelles au Lycée grâce à mon professeur de Français lorsque
j’étais en classe de seconde. Les nouvelles m’ayant le plus touché sont
« le sourire de Marko », « le lait de
la mort » (je me souviens encore de cette nouvelle 14 ans après !),
« le dernier amour du prince Genghi »,
« L’homme qui a aimé les Néréïdes »,
« Notre-Dame-Des-Hirondelles », « La
fin de Marko Kraliévitch »
et « La tristesse de Cornélius Berg ». En gros, l’essentiel des
nouvelles composant ce recueil !
Jérôme
Pons
(Paris, 11
mars 2006)
(révisé le 18 mars 2006)
chroniques > 2005
mai > Miguel de Cervantès (1547-1616):

Que vient
faire Miguel de Cervantès dans le siècle d’Or?
« En
un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme… »
Chapitre
XXXIX : Cervantes donne de nombreux
repères historiques :
- Un
navire chargé de laine part d’Alicante pour Gênes (Italie)
- Allusion
au Piémont
- Le
duc d’Albe passe en Flandre pour y mener des campagnes menant à la mort
des comtes d’Egmont et de Horn. Le capitaine Diego de Urbina (de
Guadalaja) y est mentionné.
- Après
la campagne de Flandre il est également mentionné que le pape Pie V a fait
alliance avec Venise et l’Espagne contre l’ennemi Turc commun qui venait
de s’emparer avec sa flotte de l’île de Chypre encore sous la domination
de Vénitiens. Ces faits sont véridiques et la l’Empire Ottoman a bien
tenté de conquérir Chypre de 1570 à 1571 suite à quoi Pie V . Il suscita
contre l’Empire Ottoman (voir Turquie) la Sainte Ligue dont les
forces remportèrent la victoire de Lépante en 1571.
- Cervantes
précise ensuite que l’amiral de la (Sainte) Ligue devait être don Juan
d’Autriche (« frère naturel du roi Philippe ») et que d’immenses
préparatifs de guerre étaient en cours. Ensuite, partant de Gênes, puis
par Naples, don Juan d’Autriche devait rejoindre la flotte vénitienne à
Messine pour participer à la bataille de Lépante [1571]. C’est amusant car
l’histoire retiendra que don Juan d’Autriche était le demi-frère de
Philippe II.
- Ensuite,
Cervantes raconte comment « Ouchali, roi d’Alger, corsaire habile et
intrépide, avait attaqué et pris la galère capitane de Malte » si
bien que le narrateur se retrouve dans la galère ottomane et se fut
conduire à « Constantinople, où le Grand Turc Sélim nomma son maître
général de la mer, parce qu’il avait fait son devoir pendant la bataille
[de Lépante] et rapporté comme preuve de son courage l’étendard de l’ordre
de Malte ».
- En 1572, le
narrateur était à Navarin, ramant sur la galère amirale (donc toujours
prisonnier). Il « vit comment les nôtres [les Chrétiens] manquèrent
l’occasion de surprendre dans le port toute la flotte turque ; les
hommes d’équipage et les janissaires [troupe d’élite ottomanes] » se
tenant prêts, persuadés qu’ils allaient être attaqués et prenant la fuite
par voie de terre sans attendre le combat. Ainsi, « Ouchali se
réfugia à Modon, une île proche de Navarin où ses hommes
débarquèrent ; il fortifia l’entrée du port et s’y cantonna jusqu’au
départ de don Juan [d’Autriche] ».
- « Au
cours de cette expédition [dans l’île proche de Navarin ], le nôtres
[les Chrétiens prisonniers] s’emparèrent d’une galère appelée La Prise,
dont le capitaine était fils du fameux corsaire Barberousse. C’est la
capitane de Naples, appelée La Louve, qui remporta cette victoire,
conduite par […] l’invincible capitaine don Alvaro de Bazan, marquis de
Santa Cruz. »
- Puis,
Cervantes raconte comment le narrateur appris en 1573 comment « don
Juan [d’Autriche] avait pris Tunis aux Turcs [qui avaient conquis la
Tunisie vers les années 1520] et installé Moulay Ahmed à la tête du
royaume, ruinant les espérances qu’avait Moulay Ahmida, le Maure le plus
cruel et le plus hardi que le monde ait connu, de remonter sur le trône.
Le Grand Turc fût très affecté par cette perte et […] signa la paix avec
les Vénitiens ».
- En 1574, le
Grand Turc « attaqua La Goulette et le Fort que don Juan [d’Autriche]
avait laissé inachevé, à côté de Tunis ». Cervantes raconte que La
Goulette et le Fort ne contenaient pas plus de 7000 soldats et qu’ils ont
été attaqués par « plus de 400 000 Maures et Arabes venus de
toute l’Afrique ». Cervantes se réjouit de cette perte [espagnole] en
s’attaquant directement à Charles Quint : « le ciel avait
accordé à l’Espagne une grâce et une faveur particulières en permettant
que fût rasé ce repaire de tous les crimes, cette Tarasque, cette éponge
qui absorbait inutilement des sommes fabuleuses, à seule fin de conserver
la mémoire de son conquérant, l’invincible Charles Quint, comme s’il
fallait ce tas de pierre pour la rendre éternelle [la mémoire] ».
Après avoir tué plus de 25 000 ennemis, des trois cents survivants du Fort
et de La Goulette, le soldat émérite valencien Juan Zanoguera, responsable
de la défense d’un fortin proche du fort, se rendit sans condition, le
commandant du fort, Gabrio Cervellon, fut capturé et le commandant de la
Goulette, don Pedro Puertocarrero, fut capturé et mourut avant d’atteindre
Constantinople, le lieu de captivité des survivants.
Chapitre
XL : Ensuite, « les
deux places s’étend rendues [Le Fort et La Goulette], les Turcs ordonnèrent le
démantèlement de La Goulette […] on la mina en trois endroits ; mais aucun
explosif ne put venir à bout [… des] murailles anciennes tandis que ce qui
restait des fortifications érigées par le Fratin s’écroula sans effort ».
Aprs un retour victorieux de la flotte turque à Constantinople, Cervantes
raconte que le maître du Ouchali Fartax narrateur esclave mourut quelques mois
plus tard. Cervantes raconte comment il est devenu roi d’Alger. En effet après
avoir été l’esclave du Grand Turc pendant 14 ans (en ramant sur les galères) et
alors âgé de 34 ans il a renié sa foi (ce devait être un chrétien à l’origine,
fait prisonnier par les Turcs) pour devenir musulman afin de se venger. Il se
distingua alors par son courage et devin roi d’Alger puis amiral en chef, qui
est la troisième charge de l’Etat. A la mort de Ouchali Fartax, ses 3000
esclaves (traités avec humanité) furent répartis entre le Grand Turc et ses
renégats. Il fut remplacé par Hassan Aga qui devint à son tour roi d’Alger. Le
narrateur passa alors plusieurs années dans les géôles d’Alger avant d’être
libérés.
Cervantès qui était à
cette époque détenu prisonnier à Alger a fait quatre tentatives dévasions dont
il parle également au travers du narrateur : « je pensais faire à
Alger d’autres tentatives [d’évasion], car je n’avais jamais renoncé à l’espoir
de recouvrer la liberté : et, lorque le projet que j’avais formé ne
réussissait pas, je cherchais sans me décourager un nouvel espoir auquel me
raccrocher, si mince et faible fût-il. C’est à cela que j’occupais mes jours
dans une prison que les Turcs appèlent un bagne, où ils enferment les captifs Chrétiens,
aussi bien ceux du Roi que ceux qui appartiennent à des particuliers, ou encore
à la ville. »
L’histoire montrera que le narrateur
décrit précédemment a de très fortes chances d’être Cervantès
qui aurait commencé à écrire don Quichotte durant les cinq années de captivité
à Alger, après avoir été capturé en Méditerranée. Préalablement, l’épée au
poing, il avait participé contre les Turcs à la bataille de Lépante (1571), à
celle de Navarin (1572) puis à la prise de Tunis (1573). [21]
En effet, d’après [16] :
·
En 1569, Cervantès réside à Rome
·
En 1570, Cervantès s’enrôle de Rome comme soldat dans
l’expédition maritime contre les Turcs et commandée par le général des armées
pontificales Mac Antoine de Colonna
·
Le 3 octobre
1571, les flottes coalisées de l’Espagne, de Venise et du Sains Siège sous le
commandement de don Juan d’Autriche, reportent à Lépante la victoire sur les
Turcs. Cervantès est alors blessé à la main gauche et hospitalisé à Messine.
·
En 1572, Cervantès
participe à la campagne navale de don Juan d’Autriche.
·
En 1573 a lieu
une nouvelle expédition de don Juan d’Autriche contre Tunis et La Goulette à
laquelle prend part Cervantès
·
En 1574, Cervantès s’installe en Sicile puis à Naples
·
En 1575, en regagnant l’Espagne, Cervantès est fait
prisonnier au large des côtes catalanes par le pirate barbaresque Arnaut Mami et est conduit à
Alger.
·
Tentatives d’évasions de Cervantès de sa geôle
d’Alger :
o
En 1576 : première tentative
o
En 1577 : seconde tentative
o
En 1578 : troisième tentative. Parallèlement, mort de
don Juan d’Autriche
o
En 1579 : quatrième tentative d’évasion. Cervantès
obtient la grâce du pacha d’Alger.
·
En 1580, Cervantès est libéré et rejoint Madrid
En
mai 2005, je terminais la deuxième partie de « Don Quichotte » et
comme pour la première partie, je me suis régalé. Sancho
Panza se rebelle réellement dans cette seconde
édition et tend à copier son mettre tant dans ses plaidoiries que dans son
attitude. Encore une fois, voici quelques notes, chapitre par chapitre :
Chapitre VIII :
Cervantès s’adresse aux historiens espagnols dans la voix de Sancho : « Et même si je n’avais d’autre mérite
que de croire sincèrement et fermement en Dieu et en tout ce qu’affirme et
croît la Sainte Eglise catholique romaine, sans oublier ma haine des juifs –
dont je suis l’ennemi mortel -, les auteurs devraient avoir pitié de moi dans
leurs écrits. » Bien entendu je ne vais pas aller plus loin dans l’analyse
de ce passage mais il m’a surpris par sa gratuité.
Chapitre IX :
Cervantès cite la bataille de Roncevaux et la mort de Roland en citant « Français, dans quel mauvais pas la
bataille de Roncevaux vous plaça ! ». Après vérification dans une
encyclopédie :
Roland : est l’un des
douze « pairs » légendaires de Charlemagne qui a été immortalisé par
la Chanson de Roland et les poèmes épiques de Boiardo et Aristote : Roland
est le modèle de chevalier chrétien et on comprend qu’il soit cité dans le
livre de Cervantès. Parmi les poèmes épiques dur Roland : « Roland
amoureux » (commencé par Boiardo en 1495) et « Roland furieux »
(suite de « Roland amoureux » réalisé par Aristote en 1532) ;
Charlemagne ou Charles Ier Le Grand (747-814) :
roi des Francs de 768 à 814, empereur d’Occident de 800 à 814 et fils aîné de
Pépin le Bref. Il a conquis les terres suivantes :
·
Lombardie (774) au nord de l’Italie
·
Frise occidentale (785) au nord-est de l’Allemagne
·
Saxe (804) au nord-ouest de l’Allemagne
·
...
Mais
Charlemagne a échoué dans la conquête de l’Espagne musulmane et doit créer une
zone de sécurité au sud des Pyrénées (la marche d’Espagne). De la même manière,
Charlemagne créera une zone de sécurité entre la France et la Bretagne (la
marche de Bretagne en 789-790). En 813 ; Charlemagne fera couronner son
fils Louis le Pieux.
Bataille de Roncevaux :
le 15 août 778, cette bataille eu lieu entre l’armée de Charlemagne (conduite
par le comte Roland) et celle de l’Espagne musulmane (les Vascons, ancienne
peuplade ibérique établie entre les Pyrénées et l’Ebre et qui donnera la
Gascogne et le Pays-Basque) dans un vallon boisé des
Pyrénées proche du col de Roncevaux ou d’Ibañeta et
où l’arrière garde de l’armée de Charlemagne fut taillée en pièces par les
Vascons, alliés des Sarrasins.
Chapitre LXVII : à
partir d’une digression sur l’alcôve (renfoncement aménagé dans une chambre
pour recevoir un ou plusieurs lits ; au sens propre), Cervantès énumère
des noms en « al » d’origine arabe : albogue,
alchimiste, alcôve, alcazar, aldée, alfange, albatros et alguazil.
Jérôme
Pons
(Paris, mai 2005)
(révisé le 30 juillet 2010)
chroniques > 2004
chroniques > 2003
octobre > Exposition pink floyd
interstellar :
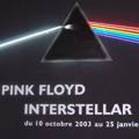
Date: Du 10 octobre 2003 au 25
janvier 2004
PAF: 6 € 50 (entrée plein tarif)
Lieu: Cité de la musique de la
Villette (www.cite-musique.fr)
Introduction:
A l’occasion de la ré-édition de l’album « The dark side of the moon » pour son trentième anniversaire, la
Cité de la musique de la Villette (Paris) organise une exposition consacrée à
son auteur : Pink Floyd.
Non seulement l’album y est présenté mais également une rétrospective de ce
groupe mythique des années 1970 avec la période psychédélique de « The piper at the gates of dawn »,
la période « The Wall », la
période post Roger Waters (le bassiste et leader du groupe) avec les albums
« The division bell » et
« Pulse ». Des instruments
utilisés lors des tournées ou lors des séances d’enregistrement des albums sont
également présentés.
Tout commence à Cambridge (Angleterre) en 1962 entre Syd Barrett (premier
guitariste/chanteur) et David Gilmour (second guitariste/chanteur), amis
d’enfance, et Roger Waters (bassiste), Nick Mason (batteur) et Richard Wright
(clavier), amis également et membres du groupe Screaming Abdabs (1963) puis Sigma
6 (1963-64).
De son côté, Syd Barrett officie au sein de Geoff Mott & The Mottos (1963-64), The Hollerin Blues (1963) et Those
Without (1963) alors que David Gilmour joue avec les New Comers (1963-64), les Joker’s
wild 1 à 4 (1963-67) puis Bullit/Flowers
(1967).
A l’automne 1964, Syd Barrett part étudier à Londres et s’installe dans un
appartement proche de celui de Roger Waters qui lui présente alors Nick Mason
et Richard Wright. Tous les quatre s’associent alors pour former Leonard’s Lodgers (1964) puis The Spectrum Five (jusqu’à fin 1964).
Cette formation sera successivement rebaptisée Tea Set (1964-65), The Pink
Floyd Sound (1965), (The) Pink Floyd (1965-67) puis Pink Floyd sous l’impulsion de Syd
Barrett. 1967 marque un tournant avec l’arrivée de David Gilmour qui remplacera
progressivement Syd Barrett qui sera écarté du groupe en 1968. Syd Barrett
poursuivra sa carrière en solo avec trois superbes albums (auxquels certains
membres de Pink Floyd ont participé) puis au sein des Stars (1972).
la période psychédélique :
Au milieu des années 1960 apparaît le « psychédélisme »,
clairement associé avec LSD, et le « Pop
Art » (associé aux reliques en plastique orange et vert qui traînent
encore chez nos parents !) Vers 1966 sont alors introduits de nouveaux
instruments à la formule de base (chant, guitare, basse, batterie, clavier)
avec le clavecin, le mellotron, les instruments indiens (sitar, tabla…) et des
pédales d’effet telles que la Wah-wah (immortalisée par Jimi Hendrix et les
B.O. des séries TV américaines des années 1970) et la Fuzz (plébiscitée par des
groupes tels que 13th Floor Elevator,
et plus récemment The Fuzztones et The Raveonettes). A cette époque, les
concerts underground sont délirants et le dandysme y fait légion. Le mouvement
psychédélique prend racine sur la côte ouest américaine (San Francisco) ainsi
qu’à Londres.
De cette période naîtront trois superbes albums : « The piper at the gates of dawn »
(1967), « A saucerful of secrets »
(1968) puis « Ummagumma »
(1969) avec des morceaux à la fois planants et techniques tels que « Astronomy Domine » et « Interstellar Overdrive »
préfigurant les orientations futures de Pink Floyd vers le « Space rock ».
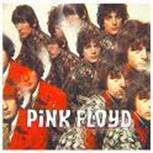
la période exploratrice :
Avec les albums « Atom Heart
Mother » (1970), « Meddle »
(1971) et son remarquable « Echoes »
qui dure plus de 20 minutes, puis « The
dark side of the moon » (1973), Pink Floyd atteint des sommets en
terme d’exploration sonore. Mais ceci n’aurait pu être possible sans le recours
massif aux instruments alors en vogue à l’époque : les synthétiseurs
analogiques, les pédales d’effet, la guitare « steel », la « talk
box » (vocoder pour guitare), les bandes son inversées… Cette période
est au cœur de l’exposition.
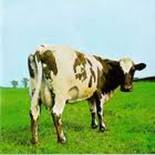
les documentaires présentés :
Au cours de l’exposition, de nombreux documentaires vidéo sont
présentés : les concerts de la période psychédélique, la préparation en
studio de l’album « The dark side of
the moon » et en particulier l’utilisation par Roger Waters du
synthétiseur VSC3 - sur lequel nous allons revenir -, quelques extraits du film
« The Wall » (1979) et de
celui de la tournées « Pulse »
(1995). Mais bien sûr ce n’est pas tout et vous en jugerez par vous-même.

les auditoriums :
Quelques cabines ont également été aménagées afin d’écouter des morceaux de
Pink Floyd au son Dolby 5.1 (5 enceintes). Je me suis ainsi prêté à ce petit
jeu en m’immergeant dans une minuscule cabine (celle qui se trouve entre la
batterie de Nick Mason et le synthétiseur Synthi Hi-Fli de David Gilmour) pour
déguster quelques morceaux du « Dark
side ». Dommage que l’album passe en boucle et que l’on ne puisse pas
choisir son titre préféré (pour ma part il s’agit de « Time »), néanmoins, j’ai trouvé
sympathique l’écoute de « Money »
et de « Us and them »
(surtout les cœurs et le formidable solo de saxophone de Dick Parry).
les instruments :
Passons aux choses sérieuses car c’est pour cette raison que je suis allé à
l’expo : voir les synthétiseurs. Et là, je n’ai pas été déçu car il y
avait un superbe orgue Hammond Quadpod (celui utilisé par Richard Wright dans
le « Live at Pompei » )
datant du début des années 1970, un orgue Farfisa Compact Duo (utilisé
également par Ray Manzarek de The Doors
en plus d’un Vox Continental) datant des années 1960.

crédit photo : Jérôme Pons
Il y avait également un synthétiseur Synthi Hi-Fli EMS de 1973 de type
« pad » (avec deux pédales
au sol) et en guise de clou du spectacle un VCS3 EMS de 1972 (utilisé également
par Peter Townshend de The Who sur
l’album « Who’s next ») qui
a servi à réaliser l’introduction de « On
the run » de l’album « Dark
side » composée de 4 notes mises en boucle. Il s’agit d’un
synthétiseur portatif à matrice qui tient dans une mallette et se trouve au
croisement d’un jeu de société « Touché-coulé » et d’un synthétiseur
Wasp EDP (« la guêpe», de par ses couleurs). En fait, il ne s’agit pas
d’un VCS3 mais je dirais plutôt d’un Synthi A/AKS EMS, mais bon c’est du détail
d’autant plus que le second est basé sur le premier…
Sinon, on trouvait également un Clavinet Hohner D6 de 1975, utilisé par
Richard Wright dans la tournée « The
dark side of the moon », un synthétiseur Minimoog de 1970, utilisé pour la tournée « Wish you were here » et « Animals » (on comptera trois
Minimoogs sur scène), un Prophet-5 de Sequential Circuits, utilisé par Richard
Wright lors de l’enregistrement et la tournée de « The Wall ».
trucs et
astuces made in Pink Floyd:
Lors de la tournée européenne de 1977, on découvre dans l’exposition une
peau de caisse claire éventrée, appartenant à la batterie de Nick Mason, sur
laquelle figurent des bribes de phrases écrites au crayon de bois sous forme de
pense-bête (Nick Mason ne connaissait pas encore les « post-it » !) comme par
exemple : « break before end of
Dogs-6 ».
De même David Gilmour utilise un pédalier « fait maison »,
prodigue d’intégration car les câbles reliant la bonne dizaine de pédales
d’effet disparaissent sous un panneau de bois faisant office de pad. Parmi les
effets se trouve un « Noise gate »,
ce qui n’est pas très courant ! Si vous regardez avec attention les photos
du livret fournit avec l’album live « Pulse »
vous remarquerez qu’au pieds de David Gilmour se trouve le même type de
pédalier.
allez-y !
Voilà une exposition qui m’a pris en gros deux heures en traînant beaucoup
et qui s’étend sur une longue période (cinq mois) alors je ne vous presserai
pas, mais allez y faire un tour, ça vaut vraiment le détour !
Jérôme
Pons
(Paris, le
12 octobre 2003, rédigé pour Motor Six O One)
(révisé le 21 mars 2006)
(révisé le 30 juillet 2010)
chroniques > 2002
chroniques > 2001
chroniques > 2000
août > Robert Merle « La mort est mon métier » (1952) :

Ce livre décrit
l’histoire de Rudolf Hoess (Lang), commandant du camp
de concentration de Auschwitz.
Voir la section
histoire
sociale de la France.
Jérôme
Pons
(Paris, août 2000)
février > King Crimson "In the court of the Crimson
King" (1969):
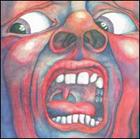
Entre
psychédélisme et rock progressif, l'on retiendra sans doute la guitare de Robert Fripp, les cuivres de Ian McDonald
ainsi que les nappes planantes des synthétiseurs et en particulier les riffs
lacérés du violon (Mellotron). Dans l’album “In the court of the Crimson King”, premier du groupe, il faut absolument
écouter sur les arrangements des cuivres, la liberté de la basse de Greg Lake (le même que dans Emerson, Lake
and Palmer !), notamment dans les aigus et les solos
de flûte merveilleux. Mais une oreille attentive écoutera en plus les breaks de
batterie saisissants de Michael Giles dont une
connaissance technique approfondie est nécessaire pour cerner toutes les
subtilités qu'elle apporte à la musique de King Crimson,
Roi Cramoisi, qui à ce jour demeure l'un de mes groupes favoris.
Jérôme Pons
(Paris, février 2000)
(révisé en
septembre 2003)
(révisé
en août 2005)
chroniques > 1999
chroniques > 1998
avril > Serge Gainsbourg « Evguénie Sokolov » (1980) :

Ce livre est très
drôle ! Il s’agit de l’histoire d’un peintre dont la source de
créativité est d’un goût plus que douteux !
Jérôme
Pons
(Rennes, avril 1998)
chroniques > 1997
février > Boris Vian « Vercoquin et le plancton » (1947) :
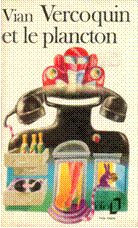
Ce livre,
rédigé entre 1943 et 1945 et appuyé par Raymond Queneau auprès de Gallimard,
est franchement ludique avec un manuel complet des techniques de drague
dans les soirées mondaines !
Jérôme Pons
(Rennes, février 1997)
chroniques > 1996
décembre > Boris Vian « L’écume des jours
» (1947) :
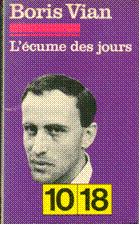
Ce livre,
achevé en 1946 et publié le 16 avril 1947, est fantastique et surtout le
concept du « piano à
cocktails »
Jérôme
Pons
(Rennes, décembre 1996)
mise à jour: 30 juillet 2010
droits d’auteur: Jérôme Pons 1996-2010
accueil – contact - musique
– histoire – littérature - cinéma - art – bandes dessinées – croquis
de bateaux – chroniques - physique – télécoms – liens - newsletters